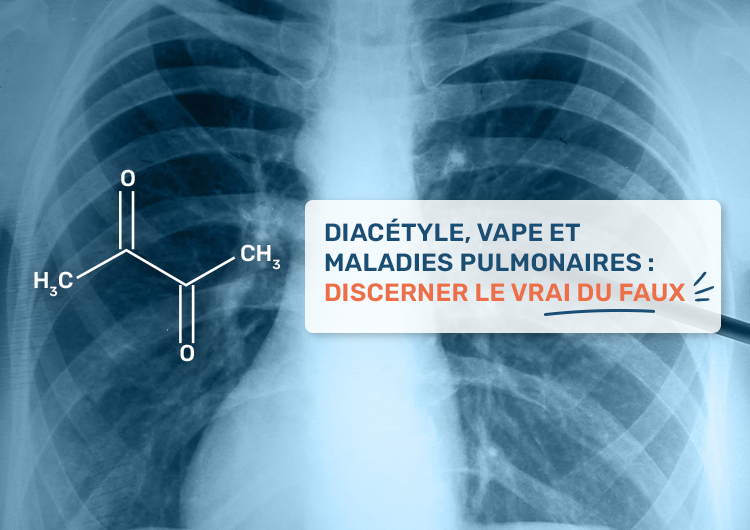Chaque année ou presque, en France, les polémiques autour de l’utilisation du diacétyle dans la vape font de nouveau la une des journaux et des réseaux sociaux. Non seulement la molécule serait à l’origine d’une maladie pulmonaire grave, la bronchiolite oblitérante ou “poumon pop corn”, mais elle serait toujours largement utilisée par l’industrie du vapotage nous dit-on. De quoi inquiéter à juste titre les consommateurs de e-liquides gourmands et plus largement les utilisateurs de cigarettes électroniques.
Pourtant, il ne pourrait pas s’agir d’une plus évidente tentative de désinformation. D’abord, parce qu’il n’existe aucun cas avéré de bronchiolite lié à l’utilisation d’une e-cigarette. De surcroît en France, puisque tous les fabricants ont proscrit le diacétyle de leurs produits par mesure de précaution, depuis plusieurs années déjà.
Explication.
Qu’est-ce que le diacétyle ?
Le diacétyle ou butanedione (C4H6O2) est une molécule organique résultant d’un processus de fermentation. Il est naturellement présent dans les produits lactés (beurre, crème fraiche, fromage…), le vin ou encore la bière.
À quoi sert-il ?
Parce qu’il a la capacité naturelle de procurer un goût beurré aux produits, le diacétyle a rapidement été synthétisé et utilisé par l’industrie agroalimentaire comme additif alimentaire, et plus particulièrement comme agent aromatisant.
Cet arôme de beurre vient ainsi parfumer nombre d’aliments, tels que les chips, les crackers, la margarine ou encore le maïs soufflé.
Jusque dans les années 2015, le diacétyle était également utilisé dans certains e-liquides français pour cigarette électronique. Principalement des liquides gourmands, type custard ou pop-corn.
À l’origine des polémiques anti vape sur le diacétyle
S’il est inoffensif lorsqu’il est ingéré, un évènement survenu dans les années 2000 dans une usine de pop-corn au micro-ondes aux États-Unis a alerté sur le potentiel nocif du diacétyle lorsqu’il est inhalé en grandes quantités.
Exposés de façon prolongée aux vapeurs de diacétyle, une dizaine d’ouvriers ont développé une pathologie pulmonaire : la bronchiolite oblitérante, aussi appelée « poumon du travailleur du pop corn » ou « popcorn worker lung ».
Récupérations et généralisations
Bien que cette maladie a été directement associée à l’exposition massive et répétée des travailleurs de ces usines à pop-corn, la polémique sur le diacétyle s’est rapidement élargie à toute la vape.
D’une maladie pourtant détectée en milieu professionnel, dans l’industrie agroalimentaire, on en a plus retenu qu’une chose : le danger du vapotage.
Preuve en est, aujourd’hui, on ne parle plus de « poumon du travailleur du pop corn », mais bien de « poumon pop corn » ou « popcorn lung ». Or, comme nous allons le voir, en supprimant ce simple mot, on a surtout supprimé le cœur même de l’origine du problème.
Les dangers du diacétyle dans la vape
Dès 2014, le docteur Konstantinos Farsalinos, éminent cardiologue grec et spécialiste des questions de réduction des risques s’emparait de ce sujet brûlant.
En décortiquant les études déjà réalisées, majoritairement à charge contre la vape, le chercheur mettait alors en lumière des biais méthodologiques flagrants, servant des conclusions volontairement alarmistes.
Procédant à ses propres calculs et expérimentations [¹], il démontrait une réalité bien plus complexe. Selon la concentration, la marque ou encore le type de produit (arôme concentré, e-liquide prêt à l’emploi…), les niveaux d’exposition au diacétyle différaient largement. Mais globalement, la plupart se trouvait à un niveau d’exposition quotidien médian inférieur aux limites fixées par le NIOSH. Soit l’Institut National pour la Sécurité et la Santé au Travail américain.
« Le diacétyle a été trouvé dans 110 (69,2 %) échantillons [sur 159 analysés à l’époque], contenant une concentration médiane de 29 μg/ml. Le niveau d’exposition quotidien médian de tous les échantillons contenant du diacétyle a été calculé à 56 μg/jour. Ce niveau est légèrement inférieur à la limite de sécurité définie par le NIOSH (65 μg/jour) »
Plus encore, en comparant ces résultats aux niveaux d’exposition quotidienne au diacétyle chez un fumeur, il confirmait l’immense réduction des risques permise par la vape.
« Considérant une consommation quotidienne de 20 cigarettes, l’exposition quotidienne médiane serait de 5 870 μg (4 970–6 195 μg) pour le diacétyle. Comme mentionné précédemment, les niveaux quotidiens médians d’exposition au diacétyle provenant de l’utilisation d’e-cigarettes ont été estimés à 56 μg. Ce qui est 100 fois inférieur à celui du tabagisme »
Par précaution, le docteur Konstantinos Farsalinos invitait tout de même les liquidiers à bannir le diacétyle de leurs produits. Ce que les fabricants français ont fait.
Zéro diacétyle dans les e-liquides français
Contrairement à ce que l’on peut lire dans les médias, le diacétyle ne fait plus partie des substances utilisées par l’industrie du vapotage. Du moins, en France.
Comme le relève l’ANSES [*], l’utilisation du diacétyle dans les e-liquides français a drastiquement diminué entre 2016 et 2019. Jusqu’à complètement disparaitre en 2020.


Source : Déclaration des produits du tabac et produits connexes en France – Produits du vapotage – Bilan 2016-2020, ANSES. Version PDF téléchargeable📃
Ce qu’il faut retenir
- À ce jour, aucune maladie pulmonaire n’a été associée à la pratique du vapotage
- Par mesure de précaution, et conformément aux recommandations de l’AFNOR [**], les e-liquides français ne contiennent pas de diacétyle
- Depuis 2017, le diacétyle fait partie de la liste des substances surveillées par l’ANSES
Notes
[*] L’ANSES, ou l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Elle approuve et contrôle la mise sur le marché des eliquides pour ecigarettes.
[**] L’AFNOR, ou l’Association française de normalisation. Elle délivre des certifications et normes garantissant la qualité et la traçabilité des e-liquides.
[¹] Farsalinos KE, Kistler KA, Gillman G, Voudris V. Evaluation of electronic cigarette liquids and aerosol for the presence of selected inhalation toxins. Nicotine Tob Res. 2015 Feb;17(2):168-74. doi: 10.1093/ntr/ntu176. Epub 2014 Sep 1. PMID: 25180080; PMCID: PMC4892705. URL : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4892705/